Traduttore, traditore
/image%2F1116647%2F20240420%2Fob_ef0dad_doughtycaesarll-g.jpg)
S’il est une locution que j’emploie fréquemment, c’est bien la paronomase italienne « Traduttore, traditore » dont la traduction en français donnerait : « Traducteur, traître ».
Il semble évident que « Traduire, c’est trahir ».
En effet, le traducteur n’étant pas dans la tête de l’auteur et n’ayant pas le même vécu, le même état d’esprit, la même connaissance des personnages, des lieux, de l’intrigue… ses choix de mots seront différents, les tournures de phrases également, chaque langue ne se prêtant pas à la même gymnastique grammaticale.
Il faut donc partir du postulat qu’un traducteur trahit forcément le texte et les pensées de l’auteur qu’il traduit.
Une fois cela établi, on peut alors dresser une échelle de traîtrise qui va de « Je fais ce que je peux pour coller au texte d’origine » à « Je m’en fous du texte d’origine et je fais ce que je veux » en passant par « L’auteur est bon, mais je vais améliorer sa prose »…
Et il faut bien avouer que certains (la plupart ?) des traducteurs s’en donnent à cœur joie, aidés en cela parfois par l’éditeur qui rajoute sa livre de sel au grain déjà déposé par le traducteur.
On a ainsi le droit à des fantaisies comme celle de Marcel Duhamel quand il traduisit « Pop. 1280 » de Jim Thompson pour en faire « 1275 âmes » supprimant ainsi 5 personnages du récit pour on ne sait quelle raison.
Mais Marcel Duhamel n’est pas le seul traducteur à s’être laissé aller à des choix plus que discutables.
On notera également le tour de magie de Henry Evie qui parvint, dans ses traductions des aventures de Arthur J. Raffles de Ernest William Hornung, à faire disparaître un tiers de chaque épisode, notamment sur le tout premier « The ides of march » où s’évapore tout le passage expliquant la rencontre entre Arthur J. Raffles et son partenaire et ami Bunny et permet de comprendre pourquoi ce second se laisse aussi facilement entraîner dans le cambriolage d’une bijouterie…
Que dire de Michel Epuy qui, en matière de prestidigitateur n’a rien à envier aux deux magiciens précédents puisqu’il parvient à transporter « The Thinking Machine » de Jacques Futrelle, un scientifique américain, et son partenaire le journaliste Hatch, en Suisse, ce dernier travaillant dès lors pour « La gazette de Genève », après avoir changé de prénom (Henry) et le premier, de Augustus SFX Van Dusen, se contente de s’appeler M. Dusen.
Et j’en passerais d’autres comme René Lécuyer qui se permit de faire sauter nombre fin ou début de chapitres voire même un chapitre entier du roman « Le crime de la 5e avenue » de Anna Katherine Green…
Les exemples sont légion et il serait quasi impossible d’en établir une liste exhaustive ni même de décerner la médaille du « Pire traducteur au monde » tant les postulants sont nombreux.
À contrario, il faut bien l’avouer, à trop vouloir respecter le texte d’origine, on peut être tenté de livrer une prose indigeste tant les tournures de phrases, les expressions et autres joyeusetés de certaines langues ne se prêtent guère à une traduction littérale stricto sensu…
Reste alors au traducteur scrupuleux de trouver un juste milieu afin de respecter au mieux l’œuvre à traduire et le lecteur qui lira ladite traduction…
Et il faut bien avouer que cela n’est pas toujours facile.
Je suis d’autant mieux placé pour en parler que j’ai très longtemps fui les traductions pour ne me concentrer que sur des récits écrits en langue française afin d’être certain de lire ce que l’auteur a voulu écrire, ayant que trop conscience de la locution liminaire à cette chronique.
Je suis désormais d’autant mieux placé que, malgré mes réticences vis-à-vis des traductions et mes griefs envers certains traducteurs, je me suis moi-même lancé dans cet exercice pour le moins difficile.
Comme pour la plupart des textes que je réédite, mon travail de traduction s’est pour l’instant porté sur des récits courts, équivalent à ceux contenus dans les fascicules de 32 pages que je chéris.
Ma première expérience de traducteur s’est portée sur les enquêtes du professeur S.F.X. Van Dusen alias The Thinking Machine de Jacques Futrelle (un auteur américain mort trop jeune à bord du Titanic).
Certaines de ces aventures avaient déjà eu l’honneur de traductions, soit pour des journaux suisses (dont j’ai évoqué la « qualité » de la traduction) et d’autres pour des magazines ou des recueils contenant des enquêtes courtes de différents détectives.
Cependant, même si j’ai retraduit certains de ces textes, je me suis plutôt concentré sur des aventures n’ayant jamais eu les honneurs d’une traduction en Français.
L’expérience fut enrichissante, car elle me permit de découvrir un personnage autrement que passivement, en tant que simple lecteur.
Effectivement, de par ma position de traducteur, je prenais une part active au récit, je découvrais les enquêtes lentement mais sûrement.
Mon but étant de respecter au mieux le texte original, j’ai cherché à coller au plus près possible à l’esprit de la plume de Jacques Futrelle.
Pas toujours facile de traduire certaines expressions ou certains mots plus que centenaires, mais toujours intéressant à faire.
Quelque temps plus tard, l’envie me vint de proposer aux lecteurs francophones de découvrir des personnages qui n’avaient jamais franchi nos frontières.
Ce fut le cas avec les enquêtes de « Lady Molly de Scotland Yard » de Emma Orczy.
Là encore, les enquêtes sont courtes et furent, à l’origine, destinées à des magazines ou des journaux.
L’auteur, Emma Orczy, eut un immense succès avec sa série sur « Le Mouron Rouge », traduite en Français et les aventures d’un autre de ses personnages furent proposées, au début du siècle dernier, aux lecteurs français (Le vieil homme dans le coin).
Pourtant, Lady Molly n’avait jamais connu cette joie. C’est désormais le cas grâce à mes traductions.
Enfin, un jour, je suis tombé sur un autre personnage dont les aventures, selon moi, méritaient également d’être proposées aux lecteurs francophones (même si certaines avaient connu une traduction en papier il y a quelques décennies).
C’est Max Carrados, un détective aveugle, dont vous pouvez désormais découvrir certaines de ses enquêtes également grâce à mes traductions.
Il est évident que je ne m’arrêterai pas là.
Déjà parce que je veux poursuivre les traductions des aventures des trois personnages évoqués. Il me reste une quarantaine d’enquêtes de La Machine à Penser ; Six de Lady Molly et une vingtaine de Max Carrados.
Mais, surtout, j’ai déjà identifié plusieurs autres personnages dont les aventures, selon moi, mériteraient de connaître une première traduction en Français.
Malheureusement, les journées ne font que 24 heures, les semaines, 7 jours, les mois à peine plus de quatre semaines et les années guère plus de 52 semaines.
En plus, j’ai d’autres séries, de langue française, dont je dois poursuivre les rééditions, des romans à écrire, d’autres à réécrire… et je suis si fainéant…
Aussi, tout cela se fera lentement… à mon rythme… rythme qui peut être influencé par les ventes (plus vous achetez une série, plus vous la lisez, plus vous la commentez et plus vous me donnez envie de vous proposer d’autres épisodes).
Bref, traduire, c’est trahir, donc, et, j’ai conscience d’être un traître, mais un traître respectueux, un traître passionné, un traître qui ne trahit que parce qu’il n’a pas le choix et non parce qu’il en a envie.
Mais si je trahis, c’est pour que vous lisiez. Alors, lisez, critiquez, parlez de ces séries (et des autres) autour de vous, conseillez-les, mettez autant de passion à les défendre que j’en mets à vous les proposer.
Traduire, c’est trahir, mais lire, c’est soutenir…

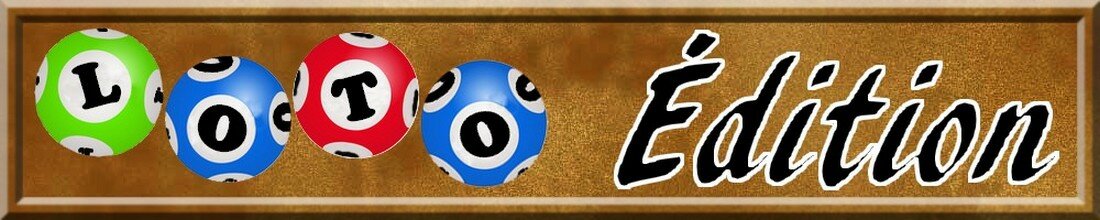
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F62%2F1030078%2F110548550_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F18%2F20%2F1030078%2F103857589_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F06%2F1030078%2F103857221_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F92%2F74%2F1030078%2F103857061_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F78%2F21%2F1030078%2F103856890_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F47%2F1030078%2F115515482_o.jpeg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F59%2F68%2F1030078%2F115502102_o.jpeg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F80%2F1030078%2F107486824_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F59%2F87%2F1030078%2F95868078_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F06%2F1030078%2F94808149_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F78%2F59%2F1030078%2F85715694_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F98%2F1030078%2F83580276_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F71%2F1030078%2F78357547_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F98%2F1030078%2F78356813_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F64%2F1030078%2F78350006_o.jpg)
:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F84%2F1030078%2F78349197_o.jpg)


/image%2F1116647%2F20240415%2Fob_0c177e_jdv07.jpg)
/image%2F1116647%2F20240415%2Fob_f5e6cc_e0971586de405fbd902ad2102ce6.jpg)
/image%2F1116647%2F20240409%2Fob_7be6f3_jdv06.jpg)
/image%2F1116647%2F20240408%2Fob_846c9c_51fevdpxl0l-ac-uf1000-1000-ql80.jpg)
/image%2F1116647%2F20240405%2Fob_658dbc_ca08.jpg)
/image%2F1116647%2F20240309%2Fob_4812ce_max-carrados.jpg)
/image%2F1116647%2F20240324%2Fob_b1a65a_ds01.jpg)
/image%2F1116647%2F20240227%2Fob_d983ff_lrdp02.jpg)
/image%2F1116647%2F20240309%2Fob_511c0e_lrdp02.jpg)
/image%2F1116647%2F20240325%2Fob_17981b_lrdp01.jpg)
/image%2F1116647%2F20240228%2Fob_ed8cb2_91citzxl54l-ac-uf1000-1000-ql80.jpg)
/image%2F1116647%2F20240317%2Fob_83ad75_jl01.jpg)
/image%2F1116647%2F20240314%2Fob_09bf20_vol6.jpg)
/image%2F1116647%2F20240309%2Fob_654da2_lord-peter-et-le-bellona-club-1449959.jpg)
/image%2F1116647%2F20240325%2Fob_3d0122_134355582.jpg)
/image%2F1116647%2F20240308%2Fob_273d12_516thxfmqol-sx195.jpg)
/image%2F1116647%2F20240228%2Fob_9633c1_vol5.jpg)
/image%2F1116647%2F20240309%2Fob_ce34a3_lm01.jpg)
/image%2F1116647%2F20240325%2Fob_5169f2_134407238.jpeg)
/image%2F1116647%2F20240325%2Fob_b46161_vol4.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F540564.jpg)